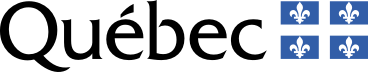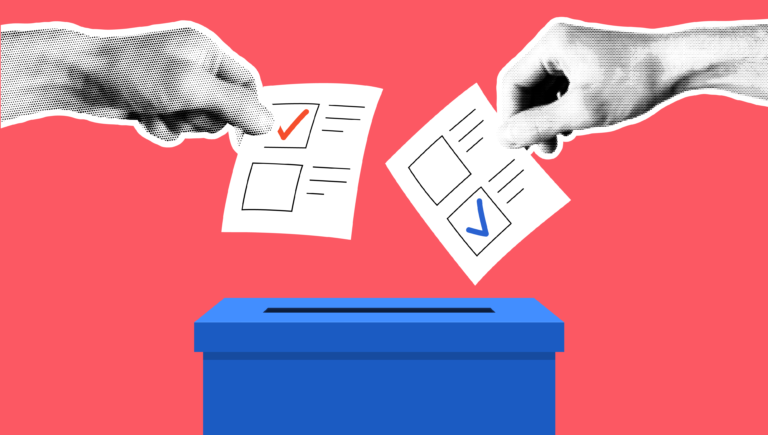Le féminisme se fait plus vocal à l’époque, mais l’université n’est pas encore au diapason. Lorsque Francine Descarries propose son sujet de mémoire de maîtrise à l’Université de Montréal (UdeM), elle est l’une des seules à travailler sur un sujet féministe. Publié en 1980 sous le titre L’École rose… et les cols roses, son ouvrage offre une première lecture féministe de la division sexuelle du travail et de la reproduction sociale à l’école et dans le monde du travail. Il contribuera fortement à l’essor de l’analyse des rapports sociaux de sexe au Québec.
En 1978, avec deux autres chargées de cours, elle conçoit le premier cours sur ce qu’on appelait alors « la condition des femmes » à l’UdeM. Au doctorat, elle-même devra bifurquer vers la sociologie des sciences, faute de professeur pour la diriger dans la rédaction d’une thèse féministe. Ce n’est pas son premier compromis. Adolescente, elle abandonne ses études après la mort de son père pour aller travailler, afin que son frère puisse poursuivre ses études de médecine. C’est à 27 ans, au Cégep Édouard-Montpetit, que s’amorcera vraiment son parcours vers les études supérieures.
Transformer les rapports sociaux… et domestiques
Aujourd’hui, Francine Descarries est une figure de proue des études féministes au Québec. « Pour moi, les études féministes forment une démarche critique et une problématique d’action visant une transformation en profondeur des rapports sociaux de sexe, comme de la façon de penser, de dire et d’agir le genre », explique-t-elle.
Plus féministe sociologue que sociologue féministe, elle traque les biais de genre dans la production des savoirs et des cultures, déconstruit les modèles théoriques dominants afin d’imposer le sexe/genre comme catégorie critique d’analyse, introduit la parole et les expériences des femmes dans la méthodologie et interroge la production/reproduction des inégalités entre hommes et femmes et entre les femmes elles-mêmes. Parce que les femmes ne forment pas un bloc homogène et ont des besoins très différents selon leur position sociale, l’analyse féministe doit adopter une perspective intersectionnelle.
Francine Descarries constate que les études féministes restent encore marginalisées dans le champ scientifique, mais elle croit que les connaissances qu’elles génèrent imposent de nouvelles directions aux courants de pensée dominants et remettent en cause nombre de leurs paradigmes. La base de données Expert@, mise en ligne par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF), répertorie plus de 300 chercheuses et chercheurs universitaires œuvrant dans le domaine des études féministes, de genre et sur les femmes. Le Québec compte maintenant quatre instituts universitaires de recherche et d’études féministes.
Changer les comportements et les mentalités est un long processus. « La charge mentale de la famille, par exemple, pèse plus lourd sur les femmes et constitue un obstacle à de nombreuses carrières, rappelle la chercheuse. Les structures de la société ont évolué, les mentalités aussi, mais cela peine à se traduire dans les activités de tous les jours. Il faut repenser les rapports sociaux dans une perspective d’égalité et d’équité plus large. »