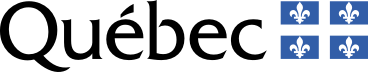Bien qu’elle soit surtout appréciée dans les salles de concert, la musique instrumentale retentit dans notre quotidien, par exemple, dans nos films, nos séries télévisuelles et nos jeux vidéo. Pourtant, les conditions de travail des compositeurs et des compositrices restent méconnues.
Danick Trottier, chercheur au Département de musique de l’Université du Québec à Montréal, a mené une étude pour mieux comprendre dans quelles conditions s’exerce le métier de composition de musiques issues de l’héritage classique au Québec.
Il a recensé la documentation disponible à ce sujet et a effectué un sondage auprès des créatrices et des créateurs musicaux du Québec. Les résultats montrent une profession résolument masculine (à environ 80 %) exercée par des personnes qui détiennent très souvent un diplôme d’études supérieures, en plus d’avoir débuté la musique en bas âge.
Si certains occupent des emplois stables, notamment dans l’enseignement, la plupart sont des pigistes. Leurs revenus sont plutôt faibles et irréguliers. Le chercheur a aussi noté une proportion importante de personnes qui occupent des emplois en dehors de la musique pour subvenir à leurs besoins. Même dans leur métier de composition, ces personnes sont aussi appelées à exécuter plusieurs tâches connexes non rémunérées, dont négocier des contrats et remplir des demandes de subvention.
Le contexte actuel ne leur facilite pas la vie. La montée de l’intelligence artificielle pourrait engendrer une baisse de la demande. De manière générale, les compositeurs et les compositrices doivent s’adapter rapidement aux changements. L’étude révèle aussi un manque de reconnaissance flagrant de ce métier dans l’espace public.
Ces données comblent un vide important et ont été partagées avec les milieux de pratique, comme le Centre de musique canadienne (CMC) et la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), et les milieux scientifiques, notamment le réseau DIG ! sur les différences et les inégalités de genre dans le domaine de la musique au Québec.