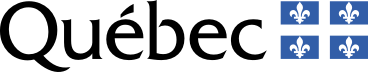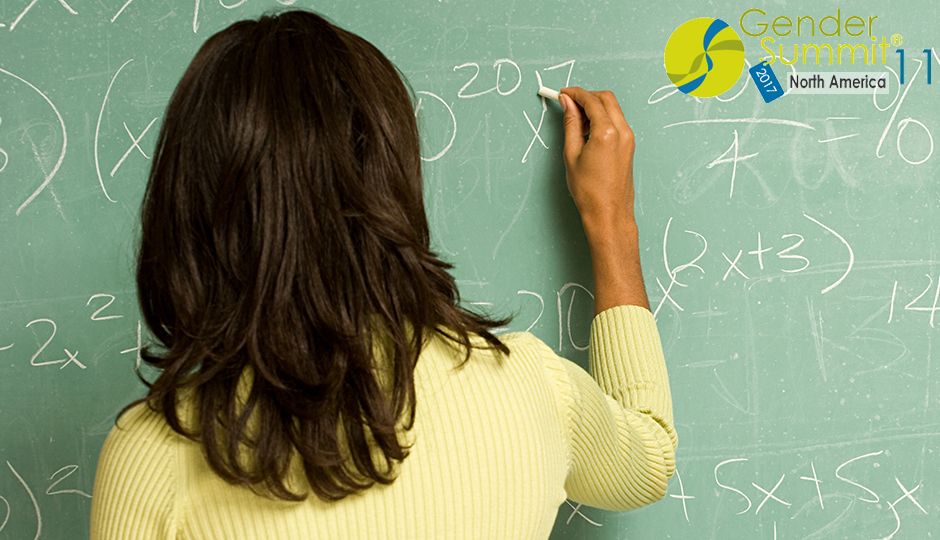Chercheuse au Centre de recherches mathématiques et au Centre Robert-Cedergren de l’Université de Montréal, Nadia El-Mabrouk développe des algorithmes – un ensemble d’opérations mathématiques – qui servent à gérer, traiter, comparer et archiver la quantité phénoménale de données issues de la biologie et de la biochimie. Par exemple, les bases de données du National Center for Biotechnology renferment des dizaines de millions de séquences de protéines et plus de 100 000 génomes séquencés. « Mes travaux visent à aider les chercheurs à résoudre certains problèmes biologiques et à déceler des modifications survenues au cours de l’évolution, par exemple, au niveau du code génétique et de la machinerie de transcription et de traduction de l’information génétique », explique la bio-informaticienne.
À chaque pays ses défis
Une telle carrière aurait probablement été plus compliquée à mener si cette mère de famille était restée dans son pays d’origine, la Tunisie. « Dans les pays arabes, les relations hommes-femmes sont très différentes, raconte-t-elle. En particulier, la conciliation travail-famille y est plus difficile qu’au Québec et s’accorde mal avec le métier de chercheuse, qui nécessite de voyager souvent pour présenter ses travaux. » Nadia El-Mabrouk apprécie la liberté incroyable et l’estime dont jouissent les Québécoises.
En toute relativité, l’informaticienne admet néanmoins que le Québec souffre des stéréotypes liés au choix de carrière. En France et en Tunisie, où les sciences sont très valorisées, il y a beaucoup de jeunes filles en mathématiques et en informatique. Au Québec, la gente féminine semble fuir les calculs et les ordinateurs. Selon Nadia El-Mabrouk, le problème est d’ordre culturel. Les mathématiques et l’informatique sont victimes de stéréotypes : matières pour les geeks et les hackers, domaines trop techniques pour une femme, etc. Selon elle, l’école n’en fait pas assez pour éliminer ces visions réductrices. Les manuels scolaires d’éthique et de culture religieuse, par exemple, différencient encore aujourd’hui des fonctions et des statuts sociaux selon le sexe. « On ne va pas suffisamment à l’encontre des idées reçues selon lesquelles les filles seraient génétiquement programmées pour les soins de santé alors que les garçons auraient un esprit plus mathématique, s’insurge-t-elle. Il faut abandonner les discours stéréotypés et laisser les jeunes faire leurs choix en fonction de leurs goûts, et non selon leur sexe. » Pourquoi ne pas leur présenter des modèles comme celui qu’offre Nadia El-Mabrouk ?