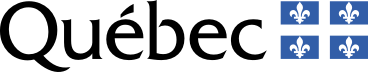Le 22% d’entre elles vivraient avec les conséquences d’un TCC modéré à sévère. Une lésion cérébrale acquise (LCA) comme le TCC peut contribuer à la survenue de la précarité résidentielle et l’itinérance et nuire aux efforts des personnes pour retrouver un logement et le conserver. Par ailleurs, la situation d’itinérance entraine une dégradation de l’état de santé de la personne, ce qui peut contribuer à amplifier les difficultés liées à la LCA et à diminuer l’accès aux services appropriés. Au Québec, malgré une préoccupation grandissante des milieux de pratique face à cet enjeu, peu de connaissances sont disponibles sur les réalités des personnes en situation ou à risque d’itinérance qui vivent avec une LCA, ou les pratiques susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. Notre équipe a mené une synthèse collaborative des connaissances en trois volets, soit des entretiens auprès des personnes premières concernées, des entretiens auprès du personnel impliqué auprès d’elles et une recension des écrits sur les pratiques de prévention et de réduction de l’itinérance chez les personnes ayant une LCA. Les résultats montrent en particulier qu’au Québec, les personnes en situation d’itinérance ayant subi une LCA présentent de nombreux besoins sociaux et de santé non comblés liés à leur LCA et évitent de recourir aux services existants, qui sont peu adaptés pour y répondre. Cette situation constitue à la fois une violation des droits des personnes ayant une LCA et contribue aux inégalités de santé vécues par les personnes en situation d’itinérance. Les résultats montrent l’urgence d’améliorer l’accès, la qualité et la continuité des soins au sein du réseau de santé et de services sociaux pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance. Une approche intersectorielle misant sur les forces du milieu communautaire œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance, du milieu communautaire spécialisé en TCC ou LCA, ainsi que du réseau de santé et de services sociaux, permettrait d’offrir des services de santé flexibles, humains, accessibles et adaptés aux réalités des personnes qui sont actuellement privées de leur droit à des services de santé équitables. Cette approche permettrait également d’améliorer la communication et la collaboration entre les milieux communautaires et institutionnels et de diminuer le sentiment d’impuissance vécu par le personnel de ces milieux.
Chercheur.e principale
- Laurence Roy, Université de Montréal
Cochercheuses et cochercheurs
- Carolina Bottari, Université de Montréal
- Mélanie Bissonnette, Projet Logement Montréal
- Marie-Ève Lamontagne, Université Laval
- Marjolaine Tapin, Connexion TCC
- Geneviève Thibault, Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement
- Vincent Wagner, Université de Sherbrooke
Collaboratrices et collaborateurs
Rachel Benoit et Naomi Bovi, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté | Benoit Desrochers, l’Auberivière | Benoit Durand, Association TCC des 2 rives | Isabel Gervais, Les YMCA du Québec | Frédéric Maari, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Laurianne Seigneur, Le Chainon | Marie-Michèle Rancourt, Réseau Solidarité Itinérance Québec.