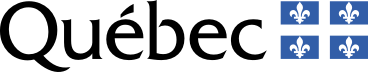Pourtant, les interventions visant à réduire cette demande restent peu évaluées. Cette revue de portée, menée dans le cadre du Programme de recherche du FRQSC sur l’exploitation sexuelle au Québec (2022), répond au besoin urgent d’identifier les stratégies les plus prometteuses en matière de prévention et d’intervention auprès des clients actuels ou potentiels de services sexuels.
Notre analyse met en évidence plusieurs approches : campagnes de sensibilisation universelle, prévention ciblée, criminalisation, programmes éducatifs, justice réparatrice, réduction des méfaits, surveillance numérique et stratégies globales ou intégrées de réduction de la demande. Si certaines de ces interventions existent depuis plus de trente ans, leur efficacité reste mal documentée. La plupart des recherches se concentrent sur les attitudes des clients plutôt que sur leurs comportements, et les études longitudinales sont rares.
Les campagnes de sensibilisation, bien qu’influentes sur les perceptions, ne démontrent pas clairement leur impact sur la réduction de la demande. La criminalisation, notamment le modèle nordique, a réduit la prostitution visible, mais a déplacé la demande vers des espaces clandestins, augmentant la vulnérabilité des personnes prostituées. Les John Schools, bien que réduisant temporairement la récidive, nécessiteraient un suivi post-programme pour avoir un effet durable. Enfin, les technologies numériques, telles que les chatbots ciblant les acheteurs en ligne, apparaissent prometteuses, mais leur impact réel doit être évalué plus rigoureusement.
Face à ces constats, une approche intégrée combinant prévention, encadrement judiciaire, accompagnement psychosocial et nouvelles technologies paraît la plus indiquée. Adapter les stratégies aux profils des clients, inclure des outils immersifs et assurer un suivi post-intervention pourraient accroître l'impact des John Schools. Une évaluation plus rigoureuse des interventions est essentielle pour guider les décisions politiques, éviter des mesures inefficaces ou contre-productives et assurer ainsi une lutte plus efficace contre l’exploitation sexuelle.
Chercheur principal
- Denis Lafortune, Université de Montréal
Cochercheuses et cochercheurs
- Nadine Lanctôt (Ph.D.), Université de Sherbrooke
- Julie Carpentier (Ph.D.), Université du Québec à Trois Rivières
- Karine Côté (Ph.D.), Université du Québec à Chicoutimi
- Francis Fortin (Ph.D.), Université de Montréal
- Mathilde Turcotte (Ph.D.), Institut universitaire Jeunes en difficulté
Collaboration
Roxane Perrin-Plouffe (M.Sc.) | Evan Marchand (B.Sc.) | Stéphanie Leduc (B.Sc.)